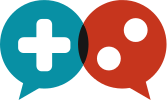Apprendre à tuer : le stéréotype persistant du joueur victime des jeux vidéo violents
Je ne me souviens plus des détails, seulement d’une simple question un peu gauche. C’était lors d’une entrevue à la télévision sur laquelle j’étais tombé par hasard, il y a de ça quelques années. La joueuse professionnelle de Counter Strike Stéphanie Harvey était invitée à discuter du nouveau phénomène des sports électroniques. Le journaliste de Radio-Canada l’avait interrompue pour lui demander, en faisant référence aux images du jeu de tir à la première personne diffusées à l’arrière-plan, si elle ne les trouvait pas un peu violentes. Je me rappelle du malaise de Stéphanie, surprise par ce soudain changement de sujet : « Oui ». Pourquoi poser une telle question, dont la réponse est évidente? J’ai senti l’écart entre deux mondes qui ne se parlent pas : l’un pour lequel la violence des jeux vidéo est troublante, l’autre pour lequel elle est considérée comme tout à fait normale, peut-être même banale, ou du moins comme étant accessoire dans l’intérêt que peut avoir un jeu. J’ai recroisé ce décalage dans la littérature scientifique, dont les catégorisations ne sont pas à l’abri de préjugés, comme l’appellation « joueurs avides de jeux vidéo violents » proposée sans considération critique par Tilo Hartmann et ses collègues (2010, p. 354). Il n’y a certes pas de crise généralisée entourant les jeux vidéo présentement, mais il en reste des résidus, voire des symptômes. Sans provoquer de remous, des inquiétudes morales à demi exprimées surgissent occasionnellement dans l’espace publique, témoignant d’une attitude défavorable figée à l’égard d’une culture toujours étrangère. Pourquoi a-t-on encore aujourd’hui peur des jeux vidéo violents? Pourquoi le stéréotype d’un joueur assoiffé de sang s’accroche-t-il à l’imaginaire collectif?
Bien que la crainte du jeu vidéo demeure de nos jours en filigrane, elle s’est manifestée sans ambiguïté lors des dernières décennies. Elle a atteint son comble en Amérique du Nord à la première moitié des années 90 dans une polémique instiguée par des politiciens américains, dont le sénateur Joseph Lieberman, dégoûté par le contenu de Night Trap et de Mortal Kombat : « On ne parle plus de Pac-Man ou de Space Invaders […] On parle de jeux vidéo qui glorifient la violence et qui apprennent aux enfants à aimer infliger les formes les plus macabres de cruautés imaginables » (dans Donovan 2010, p. 225; traduction libre). Comme dans un processus cyclique, des réactions excessives reviennent par intervalles accaparés le débat public, notamment à la sortie de jeux vidéo controversés (de Death Race aux opus de la série Grand Theft Auto) et à la perpétration de tueries par de jeunes hommes (cherchant à attribuer des causes à la tragédie, les médias remarquent que les responsables sont des joueurs de jeux vidéo violents : c’est ainsi que la fusillade de Columbine a été associée à Doom). De tels événements correspondent à ce que le sociologue Stanley Cohen nomme panique morale :
« Une condition, un épisode, une personne ou un groupe émerge pour se voir défini comme étant une menace aux valeurs et aux intérêts de la société; sa nature est présentée d’une manière stylisée et stéréotypée par les médias de masse; des barricades morales sont tenues par des éditeurs, des évêques, des politiciens et autres bien-pensants; des experts accrédités socialement prononcent leurs diagnostiques et leurs solutions » (2011, p. 1; traduction libre).
Historiquement, les paniques morales tendent à survenir en réaction à l’émergence de nouveaux médias et de nouvelles cultures liées à la jeunesse, qui viennent tour à tour menacer l’ordre établi (Drotner 1999). La littérature populaire au 18e et 19e siècle, la bande dessinée et le rock ‘n’ roll dans les années 50, les jeux de rôle sur table dans les années 70, et plus récemment, le heavy metal, le hip-hop et Internet, pour ne nommer que ceux-là, ont tous été désignés par des intervenants externes comme les boucs émissaires de maux de société reliés principalement à la délinquance juvénile. Sous l’étreinte de l’anxiété sociale, les agents du statut quo manifestent leurs insécurités en diabolisant une génération qui échappe aux traditions.
En réponse aux préoccupations de la collectivité, une partie de la recherche en psychologie et en sciences de la communication se consacre au problème des effets de la violence vidéoludique. Selon le chercheur Craig A. Anderson et ses collaborateurs (2010), l’exposition à des jeux vidéo violents est un facteur de risque à court et à long terme de comportements antipathiques. D’observer et de participer à des scénarios d’agressivité (agression scripts) implique un apprentissage par imitation et augmente les chances que l’individu, puisant dans sa mémoire, utilise ces scénarios comme « guide d’action et de résolution de problème social » (Huesmann 1998, p. 15; traduction libre). Plus l’exposition à la violence est fréquente, qu’elle devient habituelle, plus les probabilités de comportements hostiles sont élevées. Le débat sur les effets de la violence vidéoludique demeure toutefois polarisé et les travaux de Anderson et ses collègues critiqués. Parmi les failles méthodologiques notables, le psychologue Christopher J. Ferguson relève l’omission de variables testées pouvant influer sur les résultats, comme la difficulté d’un défi ludique et la nature de la compétition (2014, p. 325), l’absence de distinction entre la violence perçue à l’écran et hors de l’écran (2013, p. 65), ainsi que la tendance à généraliser excessivement les répercussions de ces jeux vidéo, à un tel point que son ampleur a été comparée à l’impact de la cigarette dans le cancer du poumon (p. 58). Un fumeur est certes soumis aux conséquences de la fumée du tabac sur sa santé, mais un individu doué de raison n’est pas tout autant impuissant face aux images. Il ne fait pas de doute que les avocats des effets néfastes de la violence vidéoludique ont un postulat de base qui colore leurs recherches et qui mérite une remise en question.
L’idée que les jeux vidéo violents puissent contaminer leur public dépend avant tout du modèle que l’on se fait du joueur. Si l’on a une conception déterministe de l’apprentissage, que l’on réduit l’être humain à l’équivalent du chien de Pavlov ou d’une page blanche sur laquelle l’on peut écrire n’importe quoi, il y a lieu de s’alarmer. Mais l’on accepte du fait même qu’il subit les événements représentés dans les médias. Le joueur n’est-il pas au contraire le moindrement conscient du contenu qui lui est proposé? Doté d’un bagage de connaissances et de croyances préalables lui permettant d’être en mesure de réfléchir par lui-même à ce qu’il voit et à ce que l’on lui fait faire en jeu? En état de produire ses propres idées et de les intégrer dans son monde de jeu? Que même dans les produits vidéoludiques dont les actions commises sont d’une violence gratuite — ce qui, avouons-le, est plutôt rare — n’est-il pas disposé à jouer sans adhérer aux valeurs véhiculées? Comme le remarque Henry Jenkins (2006), les études sur les effets de la violence vidéoludique tendent à construire un joueur passif, alors que pour reconnaître la réelle activité de ce dernier, l’attention doit être déplacée sur les significations de cette violence. C’est ici que les études du jeu vidéo peuvent contribuer à la question en examinant la culture vidéoludique par le biais d’analyses de jeux, de discours des communautés et de leurs pratiques. Ces méthodes ont l’avantage d’expliquer la violence, ses raisons d’être, ses thèmes, ses multiples facettes, y compris ses subversions, et ce de manière à rendre justice aux moindres détails unissant et distinguant chaque jeu ainsi que leur réception et leurs usages. Un tel exercice invite à la nuance et permet de résister à l’empressement de répondre par oui ou par non à une question commandée par les inquiétudes d’une partie de la population qui fait preuve d’amnésie historique, pour reprendre l’expression de Kirsten Drotner (1999, p. 610), c’est-à-dire qui participe à un débat comme si c’était la première fois dans l’histoire qu’il avait lieu. Rappelons-nous que la panique morale est un cycle. Chaque fois, elle revient avec des craintes exprimées pour une énième fois envers des phénomènes culturels et technologiques pouvant prendre des formes tout à fait variées, en autant qu’ils concernent la jeunesse et qu’ils se heurtent au « bon goût ».
Si l’on accepte que le joueur n’est pas victime de son média, mais qu’il l’adapte plutôt à ses idées et à ses curiosités, négocie le contenu présenté, fait preuve de réflexivité, on respecte alors le potentiel des jeux vidéo, que ceux-ci peuvent s’avérer salutaires en offrant des mondes temporaires et sécuritaires où il est possible d’enfiler un masque et d’essayer une autre vie. Jeroen Jansz compare en ce sens le jeu vidéo à un laboratoire privé, dans lequel le joueur peut « s’engager dans de riches et diverses activités, y compris celles qui peuvent ne pas être possibles ou tolérées dans la vie quotidienne » (2015, p. 268; traduction libre). Sachant que le jeu est jeu, le joueur possède la distance nécessaire pour explorer des situations hypothétiques qu’il ne voudrait pas connaître en temps normal. Par exemple, le fait d’incarner un hors-la-loi implique évidemment de jouer des scénarios relatifs au milieu de la criminalité, ce qui ne peut s’accomplir sans que le joueur acquiesce de plein gré à la proposition du jeu, le permettant d’en profiter pour expérimenter avec le système de règles, vérifier ce que c’est d’être un tel personnage, et même tester ses propres limites émotionnelles. Il ne ferait pas de sens de prendre part à une telle expérience si le monde du jeu et le monde ordinaire n’était pas clairement séparés. Dans le cas contraire, on pourrait certainement craindre pour l’intégrité psychologique du joueur.
Il faut malgré tout relativiser le type de comportements violents qui revient dans les jeux vidéo. Le joueur n’incarne généralement pas le mal; il le combat. La violence qu’il emploie est destinée à punir un vilain et ses acolytes, ou nécessaire pour les arrêter dans la réalisation de leurs plans machiavéliques, ses actions correspondant plus à un scénario de bravoure que d’agressivité. Même que dans la plupart des jeux de rôle et des jeux de furtivité, des options non violentes ou non létales sont fréquemment disponibles de façon explicites et peuvent s’avérer bien plus satisfaisantes que l’habituelle alternative. Des opportunités de subversion se présentent de plus à l’intérieur des jeux à monde ouvert, comme en respectant le code de la route dans Grand Theft Auto ou en refusant de chasser des animaux pour revendre leur peau, fourrure et plumes dans Red Dead Redemption. Gardons à l’esprit que peu importe le nombre et la nature des possibilités d’actions à sa disposition, le joueur intervient en jeu en toute connaissance de cause, sans quoi il n’y aurait pas à priori raison de jouer.
J’ai l’intuition que le jeu vidéo est condamné à susciter des préoccupations morales, et ce non seulement pour les raisons discutées ci-dessus. Cela ne nous empêche guère de nous tourner vers d’autres questions tout autant, si non plus pertinentes, qui elles, éclairciront notre compréhension des jeux vidéo. Pourquoi exerçons-nous une fascination envers les scénarios violents? Comment sont-ils justifiés narrativement? Qu’est-ce qui nous motive à jouer à de tels jeux? Que faisons-nous avec ceux-ci? Quels sont les rôles que peuvent occuper la violence vidéoludique? C’est en considérant le jeu et le joueur pour ce qu’ils sont réellement qu’il sera possible de surpasser le stéréotype d’un individu sans défense contre son média « dangereux », de désamorcer les craintes, et surtout, de s’armer de prudence devant un débat sans réponse définitive.
Maxime Deslongchamps-Gagnon
Bibliographie
Anderson, Craig A., Akiko Shibuya, Nobuko Ihori, Edward L. Swing, Brad J. Bushman, Akira Sakamoto, Hannah R. Rothstein et Muniba Saleem. 2010. « Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy, and Prosocial Behavior in Eastern and Western Countries: A Meta-Analytic Review », Psychological Bulletin, vol. 136, no. 2, p. 151-173.
Cohen, Stanley. |1972| 2011. « Deviance and Moral Panics », dans Folk Devils and Moral Panics, New York : Routledge, p. 1-21.
Donovan, Tristan. 2010. « Mortal Kombat : The US Senate Cracks Down on Video Game Violence », dans Replay: The History of Video Games, Lewes : Yellow Ant, p. 225-36.
Drotner, Kirsten. 1999. « Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity », Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, vol. 35, no. 3, p. 593-519.
Ferguson, Christopher J. 2014. « Is Video Game Violence Bad? », The Psychologist, vol. 27, no. 5, p. 324-7.
Ferguson, Christopher J. 2013. « Violent Video Games and the Supreme Court: Lessons for the Scientific Community in the Wake of Brown v. Entertainment Merchants Association », American Psychologist, vol. 68, no. 2, p. 57-74.
Hartmann, Tilo, Erhan Toz et Marvin Brandon. 2010. « Just a Game? Unjustified Virtual Violence Produces Guilt in Empathetic Players », Media Psychology, vol. 13, no. 4, p. 339-63.
Huesmann, L. Rowell. 1988. « An Information Processing Model for the Development of Aggression », Aggressive Behavior, vol. 14, no.1, p. 13-24.
Jansz, Jeroen. 2015. « Playing out Identities and Emotions », dans V. Frissen, S. Lammes, M. de Lange, J. de Mul et J. Raessens (dir.) Playful Identities: The Ludification of Digital Media Cultures, Amsterdam : Amsterdam University Press, p. 267-80.
Jenkins, Henry. 2006. « War Between Effects and Meaning: Rethinking the Video Game Violence Debate », dans D. Buckingham et R. Willet (dir.), Digital Generations: Children, Young People, and the New Media, Mahwah : Lawrence Erlbaum, p. 19-31.
Karlsen, Faltin. 2015. « Analyzing Game Controversies: A Historical Approach to Moral Panics and Digital Games », dans T.E. Mortensen, J. Linderoth, et A. ML Brown (dir.), The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments, New York : Routledge, p. 15-32.